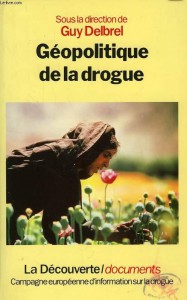- Auteur.e.s :
- Anne Coppel
Contribution
in Géopolitique de la Drogue
DELBREL G. (sous la direction de), Cahiers libres / Documents,
Éd. La Découverte, 1991, pp. 13-28.
« Les Aryens devenaient immortels lorsqu’ils avaient bu le somma (il s’agissait sans doute de l’amanite tue-mouches, que les aborigènes du Kamtchatka absorbent aussi dans l’urine de ceux qui en ont pris); les mineurs anglais avalaient des grains d’opium avant de descendre dans la mine; les Yéménites chiquent du kat lorsqu’ils rencontrent leurs amis … Les aliments seuls exceptés, il n’est pas sur la terre de substances qui aient été aussi intimement liées à la vie des peuples dans tous les pays et dans tous les temps [ … ]. Ces substances ont établi un lien entre les habitants d’hémisphères opposés, et depuis qu’elles ont imposé leur joug aux hommes, leur transport a nécessité l’établissement de voies de communication utilisées plus tard pour d’autres fins. Leur usage est devenu un trait caractéristique des peuples [ … ] qui permet d’affirmer à coup sûr l’existence de relations très anciennes et très étranges. » Ainsi s’ouvre Phantastica, publié en 1924, le premier livre qui entend regrouper, décrire et classer toutes les substances que Lewin nomme « hallucinogènes», drogues psychédéliques, stupéfiants, narcotiques, excitants (1).
Au terme d’une enquête à laquelle il aura consacré sa vie, Lewin a traversé les siècles et les océans. Il a interrogé la chimie et l’histoire, la botanique et l’ethnologie, confronté descriptions cliniques et poésie, rencontré des hommes. Minutieusement, il décrit la production, la fabrication, l’usage, les effets et les mesures de contrôle et fonde ainsi un genre nouveau qui mêle la classification et l ‘histoire des produits. Successivement, il cherche les premières traces de l’opium en Mésopotamie, quatre mille ans avant notre ère, celles du chanvre indien, tout aussi anciennes en Chine puis en Inde où il devient herbe sacrée, et gagne ensuite le Moyen-Orient et l’Afrique.
Il décrit le bétel, attesté 2 000 ans avant J.-C., chiqué tout autour de l’océan Indien et de la mer de Chine, découvre le kawa-kawa dispersé dans l’archipel australien, visite les fumeries d’opium de San Francisco, ramène enfin d’Amérique le peyotl, s’émerveille de « ces perceptions d’origine subjective intérieure ». Et en isole le principe actif auquel il donne son nom, J’Anhalonium Lewinii.
Avant lui, l’histoire des drogues n’est pas concevable, ne serait-ce que parce que la notion même de « drogues » est impensable. Pour les hommes qui les consomment, rien de commun entre la boulette d’opium avalée pour calmer dysenteries et maux gastriques et l’amanite tue- mouches, qui, dans les steppes sibériennes, ouvre le délire chamanique. Pas plus entre le fumeur de havane et les mastiqueurs de coca, ou encore les mangeuses d’arsenic qui recherchent, nous dit Lewin, le teint frais, la peau nacrée et l’œil brillant.
Si Lewin se lance à corps perdu dans l’entreprise qui fonde la psychopharmacologie, s’il s’émerveille de ces substances qui, « par-dessus les monts et les mers, ont fait l’union des peuples », c’est qu’il a vécu, avec les hommes de son siècle, l’alternance d’espoirs fulgurants et de désillusions cruelles qui ont engendré les concepts de drogues et de toxicomanie. Aux alentours des années 1870, la science avait, semble-t-il, enfin vaincu la malédiction ancestrale. Avec la morphine – GOM, God’s own medecine, la médecine de Dieu lui-même -, les hommes ont enfin vaincu la souffrance. Une foule se presse dans le cabinet médical, soldats blessés, poitrinaires, anémiques, mais aussi femmes hystériques, nymphomanes aliénées. Bientôt les hommes de l’art s’inquiètent. Ce médicament semble doué d’un pouvoir étrange. Plus on en administre à un malade, plus il en réclame. Lewin est un des premiers à observer l’appétence morphinique et les différentes phases de l’intoxication. Peu à peu le patient est pris d’une furie destructive qui le conduit immanquablement à la déchéance et à la mort.
Au rythme des caravanes
Pourquoi les hommes sont-ils pris d’une passion de consommation si funeste? La question est datée du début de ce siècle. Avant de s’interroger, de s’inquiéter ou de combattre, les hommes ont consommé des drogues dans le silence des comportements habituels tels que s’habiller, se dire bonjour lorsqu’on se rencontre, ou encore avoir des pratiques religieuses. À l’exception de celles pour lesquelles l’Occident se passionne et dont il va redoubler la férocité, nombre de ces substances ont sombré dans l’oubli – c’est le cas du bétel consommé au début de ce siècle par quelque 200 millions d’hommes. Cet excitant que l’on chique et dont la passion est commune aux deux sexes, à toutes les classes sociales et à tous les âges, était déjà connu 2 000 ans avant notre ère. Les Arabes et les Persans le rencontrèrent en envahissant l’Hindoustan aux VIlle et IXe siècles et furent peu à peu conquis. Au XVIe siècle, Marco Polo en décrit l’usage dans tout le monde musulman. Le bétel, à la fois excitant et narcotique léger, qui offre l’avantage d’apaiser l’humeur, les sentiments de faim et de fatigue, et présente peu d’inconvénients, semble-t-il, a progressé au fil des migrations, des échanges commerciaux et des conquêtes. Progression lente d’une drogue douce – en ce sens que son usage n’exige aucune modification brutale des façons de vivre – qui s’est peu à peu intégrée dans les cultures locales. Ces substances, souvent d’usage quotidien, laissent peu de traces. Même s’ils en remercient les dieux, les hommes les ont adoptées sans suspicion ou débats.
Ce n’est pas dire que la puissance des psychotropes, et particulièrement des hallucinogènes, ait été ignorée des sociétés traditionnelles. Les plantes sacrées, consommées lors des cérémonies rituelles, étaient recherchées précisément parce qu’elles bouleversent l’ordre apparent des choses, parce qu’elles permettent l’incarnation des forces invisibles, dont l’accès est interdit au commun des mortels. Ces drogues sont innombrables. R.E. Schultes et A. Hofman en ont recensé plus de 5 000, champignons, cactus, graines, racines, ou même le venin de crapaud, terreur médiévale (2). Chaque culture, quelquefois chaque tribu a usé de ses drogues propres, avec des règles et des tabous précis et, le plus souvent, une lente initiation qui en contrôle d’autant mieux l’usage que les religions primitives sont rarement prosélytes.
Trois types d’événements vont introduire brutalement les plantes à drogue dans l’histoire :
– les progrès de la pharmacologie, dont les produits sont chaque jour plus nombreux, plus puissants et plus maniables ;
– une distribution massive servie tout à la fois par l’internationalisation des échanges commerciaux et le système de prohibition des drogues qui en augmente les bénéfices ;
– les bouleversements culturels rapides et l’internationalisation de la civilisation industrielle qui contraint les hommes d’aujourd’hui à inventer des processus constants d’adaptation.
La chimie du bonheur
L’épopée qui va de l’usage de l’opium à l’invention de l’héroïne ressemble à celle de l’apprenti sorcier. Les spécialistes de la drogue dénoncent la folle ambition de l’homme à la recherche de produits chaque jour plus puissants et si difficiles à gouverner qu’il faut en chercher simultanément l’antidote. Nous pouvons à juste titre nous inquiéter avec Jean-Pierre Changeux de ce qu’après avoir massacré la nature, l’homme ne dévaste son propre cerveau (3), mais notre culture est si imprégnée de psychotropes que nous ne pouvons plus envisager de nous en passer. La toxicomanie et même la gestion de la maladie mentale ne sont que des épiphénomènes au regard des changements culturels qui affectent l’ensemble de la collectivité.
Le premier événement à cet égard, si révolutionnaire qu’il est difficile d’en évaluer les impacts, c’est la disparition de la douleur dans notre univers quotidien. La sensibilité moderne s’est forgée dans le refus de la souffrance que les générations qui nous ont précédés subissaient de la naissance à la mort avec pour seules armes la religion, la morale ou la philosophie. Les premières utilisations de l’éther comme anesthésiant rencontrèrent d’abord la méfiance : « Éviter les douleurs dans les opérations est une chimère qu’il n’est plus permis de poursuivre aujourd’hui, affirme le Dr Velpeau en 1838. Instrument tranchant et douleur sont deux mots qui ne se présentent pas l’un sans l’autre à l’esprit des malades et dont il faut nécessairement admettre l’association. » Discours plein de bon sens, mais démenti par l’histoire.
Quelques moralistes ont tenté, tentent encore de nous convaincre de la nécessité de la souffrance. Même les plus rigoristes, pourtant, ne conçoivent plus une opération sans anesthésie. Nous avons les mêmes exigences en ce qui concerne les souffrances morales. Nous ne tolérons ni les nôtres ni celles de notre entourage, et nous trouvons parfaitement légitime de traiter les deuils, les ruptures sentimentales, les séquelles de trauma par une armada de médicaments que nous voulons efficaces et précis. La pharmacologie est aujourd’hui capable de répondre à ces exigences. Il a fallu à l’humanité des millénaires pour discerner les plantes qui pouvaient modifier les états de conscience. Un siècle, le dix-neuvième, a suffi pour en identifier les principes actifs. Depuis les années cinquante, les hommes de science commencent à en comprendre le fonctionnement. Et à produire sur mesure les produits du bonheur.
« “Opium facit dormire quia in eo virtus dormitiva” : l’opium fait dormir parce qu’il a en lui une vertu dormitive. C’est ce que disait Diafoirus, le médecin de Molière … et que dire d’autre, si ce n’est remercier l’Être suprême qui, dans sa bonté, a donné les opiacés à l’humanité pour soulager ses maux » écrit Thomas Sydenham, médecin anglais du XVIIIe siècle, qui s’inscrit ici dans une longue tradition parvenue en Occident par l’entremise des Arabes et que diffusent lentement apothicaires, droguistes, médecins et charlatans.
Pour que le danger de la dépendance aux opiacés soit identifié en Occident, il a fallu d’abord que le principe actif de la plante soit isolé, qu’il soit administré directement dans l’organisme par la seringue hypodermique, qu’il soit enfin utilisé massivement. Sertüner, qui en 1805 extrait la morphine pure de l’opium, Alexanwood, qui met au point la technique de l’injection morphinique, sont les premières victimes de leur invention; la morphinomanie touche d’abord les savants, les médecins, leur femme, leur entourage proche. Une longue quête commence à la recherche du produit qui guérira du produit. C’est d’abord l’héroïne, séparée chimiquement de la morphine en 1874, puis expérimentée en 1898, et largement commercialisée dans le monde entier par· la société pharmaceutique Bayer. Le remède est heroisch, tout à fait énergique, calme toutes les toux et guérit même les morphinomanes qui abandonnent sans broncher leur produit de prédilection pour ce médicament.
Après l’héroïne, l’histoire se répète encore. Chaque alcaloïde de l’opium est exploité, des dérivés semi-synthétiques sont testés, donnent lieu à des consommations abusives et sont soumis ensuite au contrôle international de la législation des stupéfiants : hydrocodone ou Dicodid, oxycodone, hydromorphone ou Dilaudid … Les stupéfiants synthétiques – méthadone, palfium, pour ne citer que les plus célèbres – connaissent le même sort (4).
L’histoire des opiacés est en passe d’être très profondément modifiée par les recherches les plus récentes dans la mesure où l’on connaît mieux les fonctionnements cellulaires qui président aux perceptions de la douleur comme de la joie. Les molécules de la drogue se fixent sur des récepteurs qui traitent l’information sensorielle. S’il existe des récepteurs de la morphine, c’est que le cerveau lui-même produit des substances dotées d’activité de type opiacé qui sont regroupées sous le nom d’endorphines (5).
On sait aujourd’hui pourquoi les endorphines ou morphines naturelles que le corps produit pour se protéger de la souffrance n’entraînent pas de dépendance. Elles sont détruites par des enzymes sitôt qu’elles ont agi sur les récepteurs opiacés. Pour le moment, les dérivés analgésiques des endorphines n’ont pas remplacé la morphine. Leur charge électrique interdit le passage de l’estomac au sang. Mais les opiacés sont devenus de véritables sondes qui révèlent le fonctionnement du cerveau et permettent de concevoir des drogues à la fois plus puissantes et plus spécifiques.
Les convoyeurs de la drogue
Les mystères des stimulants sont aussi en passe d’être éclaircis. La coca, cadeau que le dieu du Soleil fait aux Incas, les Européens en découvrent l’efficacité dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec le vin Mariani, vin à base de coca, et surtout sous forme de cocaïne, principe actif de la plante que le chimiste Albert Nieman isole en 1860. L’enthousiasme est général. Celui de Freud, qui se présente à sa fiancée Martha sous les traits d’un « grand monsieur sauvage plein de cocaïne », est célèbre comme sa désillusion lorsqu’il entreprend de soigner son ami Ernst Fleischl von Marxov, morphinomane chez qui la cocaïne déclenche un délire psychotique.
Si la cocaïne ne cesse de faire des adeptes, les médecins y ont renoncé dès la fin du XIXe siècle. La même désillusion se produit avec les amphétamines, substitut synthétique d’une plante utilisée dans la médecine chinoise contre l’asthme, le ma huang, dont Gordon Alles fait la synthèse en 1935.
Le produit, commercialisé sous le nom de Benzédrine, est utilisé largement, sans connaître toutefois la célébrité de la cocaïne. À ce titre, il garde plus longtemps une réputation de médicament. Il est ainsi consommé de façon fonctionnelle, parce qu’il « donne du nerf » aux chauffeurs routiers, aux étudiants ou aux sportifs. En 1955, le coureur Jean·Malléac est hospitalisé dans le mont Ventoux lors du Tour de France après un abus d’amphétamines : le débat sur le doping ne fait que commencer, mais la nocivité des amphétamines était déjà bien connue. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les amphétamines ont joué un rôle actif. En quelques semaines, les armées allemandes envahissent les Balkans, la Grèce, la Crète : aviateurs, conducteurs de tanks, parachutistes sont bourrés d’amphétamines. Les pilotes de la Royal Air Force en utilisent tout autant, au point qu’un journal britannique titre : « La Méthédrine a gagné la bataille de Londres » (6). Mais l’armée britannique y renonce bientôt. Des aviateurs atterrissent sur les pistes allemandes, veulent fraterniser avec l’ennemi qu’ils ne sont même plus capables de reconnaître. L’histoire ne s’arrête pas là. Une génération de jeunes soldats ont expérimenté l’efficacité du produit qu’ils n’oublient pas de retour dans leurs foyers. Tout au long des années cinquante, jeunes ouvriers en blouson noir, rockers anglais et américains en consomment : ils veulent tenir le coup le week-end durant, résister aux fiestas et aux bastons, vivre vite. La culture de la drogue des années soixante est en gestation.
Ces drogues, qui augmentent l’acuité mentale et donnent un sentiment de puissance, qui peuvent parfois produire de véritables psychoses et calment curieusement les enfants hyperactifs, agissent en pénétrant dans les terminaisons nerveuses où elles libèrent deux neuromédiateurs, la noradrénaline et la dopamine, tous deux chargés de transmettre l’information émotionnelle, la peur, la colère, l’amour. Leur action est opposée à celles des neuroleptiques que J. Delay et P. Deniker expérimentent au début des années cinquante, et qui se révèlent capables de contrôler le délire des schizophrènes en bloquant les récepteurs à dopamine. L’efficacité de ces drogues tient sans doute à la structure chimique de la molécule, proche des neuromédiateurs, qui régule les réponses émotionnelles à l’environnement.
Les drogues les plus mystérieuses, celles qui impressionnent le plus durablement l’expérimentateur sont communément appelées « hallucinogènes », et produisent des distorsions des perceptions, perception du monde, perception de soi. Qu’elles soient traditionnelles comme le peyotl ou les psylocybes mexicains, ou qu’elles soient des produits de semi-synthèse comme le LSD tiré de l’ergot de seigle, ces drogues produisent, outre un kaléidoscope d’images fantastiques, un sentiment de dilution de soi, accompagné d’une exaltation ou d’un sentiment de révélation qui en fait la drogue mystique par excellence.
Ces drogues, proches de neuromédiateurs connus, sérotonine, dopamine, noradrénaline, agissent de façon privilégiée dans le locus oerulus, petit noyau du tronc cérébral, qui compte à peine 3 000 neurones, mais dont les arborescences sont si importantes qu’elles touchent quelque 30% à 50% des cellules du cerveau, soit plusieurs milliards. Cette partie du cerveau est à l’origine de la perception de soi et des autres. L’accélération considérable de la décharge cellulaire que provoquent ces drogues est sans doute à l’origine du sentiment d’éveil mental, comme elle est responsable des confusions sensorielles – où les sons, les couleurs, les odeurs se répondent, ce système d’information traitant également l’information sensorielle.
Les mécanismes exacts affectant la transmission, de l’information ne sont pas tous connus, loin de là, mais du moins les sites sont-ils localisés ainsi que les trajets de l’information. Ces progrès fulgurants de la psychopharmacologie permettent d’identifier la puissance relative de divers agents chimiques sur les sites récepteurs ; on peut également en déduire la structure moléculaire nécessaire pour accroître la capacité d’interaction de la drogue avec ces sites.
Les techniques mises au point par les neurosciences permettent de mesurer in vitro la liaison aux récepteurs. La seule synthèse d’un produit expérimenté auparavant sur les animaux pouvait exiger un mois de travail avant même l’expérimentation pour produire les substances utiles. Il faut aujourd’hui un ou deux jours de travail, pour des drogues chaque fois plus efficaces qu’on peut modeler en fonction d’objectifs précis. La psychopharmacologie a cessé d’être un bricolage, l’invention des drogues s’effectue désormais à une échelle industrielle et, une fois trouvées, elles peuvent être bricolées par n’importe quel chimiste.
Un commerce belliqueux
Nul n’est à même d’évaluer les conséquences d’un tel pouvoir sur le problème de la drogue, sur notre cerveau d’abord, mais aussi sur le trafic international qui en est aujourd’hui l’aspect prépondérant. La plus grande intoxication du monde n’est pas tant due à l’opium, utilisé depuis des millénaires, qu’à l’action des trafiquants sans scrupules, en l’espèce les pays européens partis à la conquête du monde.
À la fin du XlXe siècle, il y avait peut-être 100 millions d’opiomanes en Chine, entre 5 % et 10 % de la population (7) et les Occidentaux de s’interroger gravement : le goût de l’opium n’est-il pas lié à l’âme asiatique, au détachement des contingences prônées par le taoïsme ? Indéniablement, les hommes choisissent leurs drogues de prédilection en fonction des qualités qu’ils apprécient, mais les Occidentaux oublient volontiers que le goût des cultures asiatiques pour l’opium a été, si ce n’est fabriqué, du moins entretenu de gré ou de force par leurs soins, avec le plus grand cynisme. Jusqu’à ce que les Anglais en deviennent les entrepreneurs, l’usage de l’opium était strictement circonscrit. Dès la conquête du Bengale en 1792, les colons anglais imposent la monoculture de l’opium dans le seul but de nourrir la contrebande de l’opium en Chine, commerce dont la Compagnie des Indes orientales détient le monopole.
La Chine est à genoux, la Chine est empoisonnée. Les drogués moribonds s’entassent dans les fumeries, mais aussi dans les jonques humides et dans tous les quartiers mal famés. L’opium gagne l’intérieur des terres. Liberman, médecin français qui a fait toutes les campagnes d’Orient, suit la progression des troupes. Dans tel village de 280 maisons, 277 disposent d’un attirail complet d’opiomane : la pipe, le fourneau, la boîte, le stylet en métal (8). Personne n’échappe au fléau, la bureaucratie céleste s’envoie en fumée, et les géneraux contemplent leur défaite en tirant mollement sur leur pipe.
Si, pour l’Occident, l’opium est la drogue de l’Orient, c’est pour la Chine le poison importé par les barbares, contre lequel l’empire tente de se protéger. Que faire ? Les interdits impériaux se succèdent. Ils ne font qu’enrichir davantage les trafiquants. En 1839, le commissaire impérial Lin Tse Hsu propose des mesures énergiques contre les trafiquants et les consommateurs, crée des comités de suppression de l’opium, écrit enfin à la reine Victoria : « On me dit que dans votre pays il est interdit, sous peines sévères, de fumer l’opium. Cela signifie que vous n’ignorez pas à quel point cette action est nocive; [ … ] aussi longtemps que vous continuerez à faire de l’opium et à inciter le peuple de Chine à l’acheter, vous vous montrerez soucieuse de la vie de vos propres sujets et insouciante pour la vie des autres hommes, indifférente au mal que vous faites aux autres dans votre avidité au gain (9). » La réponse de la reine Victoria est sans ambiguïté. Elle juge inopportun « d’abandonner une source de revenus aussi importants ». Deux guerres, dites guerres de l’opium, en 1839 puis en 1857, ouvrent la Chine à l’Occident et à la drogue, désormais associés.
Car la Grande-Bretagne n’est pas seule à mener cette politique en Extrême-Orient. À l’imitation des Anglais, les Français en organisent le commerce. La Régie de l’opium, rationalisée par Paul Doumer, devient vite une entreprise rentable ; elle est même quelquefois la seule à laquelle l’État français s’attache : « Que de fois en arrivant dans quelque misérable hameau, je me réjouis de voir un drapeau français arboré devant une case, mais presque toujours, hélas, sur la partie de drapeau, on lisait RO, Régie d’opium. Le seul représentant de l’administration dans ce coin perdu était le tenancier du débit d’opium (10). » Jacques Pannier, chargé de la question de l’opium pour la conférence internationale de La Haye, se désole, mais la Régie de l’opium reste solidement implantée. Lorsque la Chambre des députés vote, en 1916, l’interdiction des stupéfiants, elle limite sa juridiction à la métropole, et la Régie de l’opium poursuit son commerce jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
Les Anglais n’ont pas hésité à imposer l’opium par les armes ; les Français, eux, l’utilisent comme une machine de guerre. L’Empire colonial britannique aura engendré « la plus grande intoxication » du XIXe siècle, les Français auront façonné le Triangle d’or qu’ils lèguent aux Américains en quittant l’Indochine (11). La guerre d’Indochine commence en 1946, et deux militaires français, le colonel Maurice Belleux et le capitaine Roger Trinquier, élaborent une stratégie anti- guérilla. L’objectif était d’utiliser les tribus des hauts plateaux contre le Viêt-minh. Ce concours, les tribus Méos ont accepté de l’apporter, mais elles ont mis « une condition économique : leur donner les moyens, de vendre la récolte de l’opium, ». Ce qui fut fait dans le cadre de l’« opération X », les Français transportant l’opium jusqu’à Saïgon où il était ensuite vendu par les Binh-Xuyen.
La stratégie est reprise, peu après, par les Américains. Tandis que la French Connection est démantelée, la CIA apporte son soutien aux tribus des hauts plateaux. Sous son égide, le commerce se rationalise, l’héroïne investit les grandes capitales de l’Asie, Hong Kong, Singapour, Bangkok, explore toutes les routes internationales, gagne les États-Unis par la Floride, l’Amérique centrale, l’Amérique latine, puis par l’Afrique ou l’Australie.
Sur le plan stratégique, la recette n’a pas eu les résultats escomptés, mais l’efficacité financière du dispositif a fait ses preuves, au point qu’il n’est plus de guerre moderne sans trafic de drogues. Les Soviétiques viennent d’en faire l’expérience en Afghanistan, et les drogués occidentaux paient, pour une part, le prix des guerres du Moyen-Orient. Ils ne sont pas seuls : dans les pays producteurs, le trafic international alimente aujourd’hui une consommation locale qui n’a rien, de traditionnel, mais qui, pas plus que le trafic international, ne peut être maîtrisée. La drogue est devenue un symptôme du sous-développement.
Épidémies et bouleversements sociaux
Les civilisations sont mortelles et elles peuvent mourir par la drogue ou avec elle. Au cours du XIXe siècle, la drogue devient un fléau social qui sanctionne les sociétés dégénérées. L’opiomanie chinoise en est l’illustration. Les Anglais se sont repus de la Chine malade, mais l’Empire céleste était condamné, comme sont condamnées toutes les sociétés traditionnelles devant le progrès de l’industrie. C’est le plus souvent l’alcool occidental qui préside aux exécutions mais les drogues même les plus intégrées peuvent aussi échapper aux régulations traditionnelles, et les hommes en perdent soudain le contrôle. Un drame se noue qui ne cesse de se répéter, des Esquimaux aux Indiens d’Amérique.
Avant l’arrivée des Occidentaux, le kawa-kawa est associé, dans l’archipel australien, à la vie sociale et religieuse avec des règles propres à chaque île (12). Ici, il est bu les jours de fête, là par les hommes âgés seulement, ou encore le matin, comme nous faisons du café. Dans les îles Samoa, le champ de kawa était divisé en trois parties, une partie réservée aux dieux malfaisants, une aux dieux du sommeil, et la dernière à la consommation de la famille. La préparation de la boisson est elle-même soumise à un cérémonial ; la racine, découpée en morceaux, est longuement mastiquée, quelque-fois par les jeunes filles, et le jus qui s’accumule dans la bouche ne doit pas être absorbé. Mais peu à peu, les croyances traditionnelles perdant de leur légitimité, la part des dieux s’amenuise, et le kawa-kawa peut être consommé à tout propos sans que les hommes ne s’astreignent plus au cérémonial de sa préparation. Le kawa-kawa a cessé d’être une boisson de la célébration, qui scelle l’union entre les hommes, avec laquelle l’invité est accueilli et honoré, pour devenir une boisson avilissante à laquelle se livrent les hommes abandonnés des dieux. Les missionnaires ont voulu cette dégradation, ils ont lutté contre la coutume, fait arracher les plantations et contribué à la victoire de l’alcool, avec son cortège de violence, de misère, de désespoir.
Sans doute l’alcool, en Occident, est-il tout aussi violent – et il coûte fort cher en termes de santé publique -, mais il est régulé par une tradition ancestrale qui indique les moments où boire, les quantités, la nourriture qui l’accompagne. Les tournées obéissent à un rite collectif : en France, le vin ne se boit pas cul sec. Le niveau de consommation toléré ou encouragé est certainement trop élevé mais il est régi par la collectivité ; à ce titre, il n’inquiète pas. L’alcool est devenu un fléau – pour les médecins hygiénistes du moins – avec l’avènement de la société industrielle. À la ville, les premières générations d’ouvriers se retrouvent seuls, sans le regard des autres, auquel nul n’échappe au village; bien souvent, ils ont renoncé à fonder un foyer et se réfugient au bistrot. L’alcool sert à supporter un travail harassant. C’est aussi l’alcool du désespoir. Cet alcool-là fait peur.
Épidémies, fléau social, dégénérescence, les médecins hygiénistes dénoncent le péril. A la fin du XIXe siècle, leur inquiétude gagne le monde des sciences et des arts. La décadence menace la civilisation. L’alcool frappe les ouvriers, la morphine s’attaque au Tout-Paris. Aux femmes du monde, « aux dames de la Haute Banque et de la Sucrerie (13) ». Aux femmes surtout, aux comtesses comme aux femmes du demi-monde, « toujours sur la brèche », et que la morphine aide à garder « le teint frais, les yeux brillants, l’esprit surexcité (14) ».
Dans les sociétés traditionnelles, la drogue était souvent un rite d’initiation qui marquait le passage d’un état à un autre, de l’enfance à l’âge adulte, de la vieillesse à la mort. La drogue, parce qu’elle modifie les états de conscience, aide à opérer des changements que l’individu affronte difficilement. Ces changements de rôle peuvent être conjoncturels en temps de guerre ; ils peuvent aussi être culturels. La vogue de la morphine chez les femmes de la fin du XIXe siècle est sans doute liée au changement de leur rôle. Les femmes du XIXe siècle sont loin de revendiquer l’égalité ; les féministes ne sont qu’une poignée, mais elles commencent à sortir de leurs foyers, elles s’instruisent, et certaines partent à la découverte de leurs désirs propres. Les hommes s’inquiètent de la femme libre, adultère, lesbienne, vicieuse, mais ils inventent une nouvelle figure qui les fascine : la femme fatale. Les morphinées, hystériques, détraquées, valétudinaires incarnent tout à coup ces femmes qui échappent à la loi des hommes jusqu’à en mourir.
Les morphinées sont tombées dans l’oubli, et la cocaïne que consomme la garçonne dans les années vingt n’a pas résisté à la crise des années trente. La drogue est bannie des pays occidentaux. Elle poursuit toutefois une route souterraine, et resurgit aux États-Unis au cours d’une guerre qui déchire les familles, les enfants contre les parents, les jeunes contre les vieux. La guerre est violente, elle traverse tous les pays occidentaux. Dans les pays anglo-saxons, sont revendiqués simultanément les droits civils, les droits des peuples opprimés, les droits de la femme, le droit des jeunes à une vie sexuelle, le droit de se droguer.
Car les drogues ont été hautement revendiquées, et les musiques qui les chantent écoutées par des milliards d’hommes. Nombre de revendications des années soixante ont été intégrées, les relations interindividuelles en sont sorties profondément modifiées. Très récemment, nous avons appris à évoquer la guerre épique des cheveux longs avec attendrissement et dérision, évolution qui scelle une réconciliation intergénérationnelle ; mais le droit de se droguer ne trouve pas aujourd’hui d’expression publique. L’espoir messianique qui a accompagné le LSD n’a plus cours.
Les adeptes du LSD avaient annoncé des temps nouveaux : l’homme allait désormais partir à la conquête de lui-même. Quelques ethnologues et poètes avaient tracé la voie où s’engouffre une génération à la recherche d’elle-même, dans l’espace et dans le temps. Le peyotl faisait déjà « les yeux émerveillés » des Indiens Huichols ou des Tarahuramas dans la civilisation précolombienne. Dans l’ivresse de la découverte, ces consommations traditionnelles sont confondues avec le culte du peyotl, célébré dans la Peyotl Church of Christ ou dans la Native American Church of North America, créée en 1911, et qui regroupe les Indiens de toutes les tribus convertis au christianisme, dans une même résistance à l’Amérique blanche.
Mais les Mayas n’allaient pas au paradis, le champignon qu’ils absorbaient n’avait rien d’artificiel ; c’était, selon les initiés, la chair de leur dieu. Avec Baudelaire, nous sommes entrés dans l’ère des paradis artificiels où les hommes tentent de rivaliser avec Dieu, et se condamnent par là même au châtiment divin. De ces paradis-là, les plantes à drogues elles-mêmes disparaissent peu à peu. Quant aux paradis, nous les voulons désormais sur mesure, sans peurs et sans risques, sans Dieu ni Diable. L’« ecstasy » aurait chassé l’un et l’autre, prétendent les ravers (utilisateurs de cette drogue). Restent la danse et la musique, les fantasmagories seules donnent l’illusion de l’éternité. L’histoire des drogues est d’abord celle des hommes qui les consomment. Des traditions peuvent se transmettre, des filiations peuvent se construire, les paradis artificiels ne sont pas éternels.
Notes
(2) R.E. SCHULTES et A. HOFMANN, The Botany and Chemistry of Hallucinogens, Springfield, Illinois, ch. C. Thomas, 1973.
(6) J.-L. BRAU, Histoire de la drogue, Tchou, Paris, 1968.
(7) Voir J. CHESNEAUX et J. BASTIDE, Des guerres de l’opium à la guerre franco-chinoise 1840-1885, Hatier, 1969; voir aussi F. W AKMAN, « Canton Trade and the Opium War », in J .K. FAIRBAND, The Cambridge History of China, Cambridge University Press, 1978.
(8) H. LIBERMANN, Les Fumeurs d’opium en Chine, Boulogne-sur-Mer, 1886.
(9) A. WALEY, The Opium Wor through Chinese Eyes, The Macmillan Company, New York, 1958.
(10) Jacques PANNIER, « Mémoire sur la question de l’opium, telle qu’elle se présente en France dans les colonies », préparé à l’occasion de la conférence internationale de La Haye, Coneslant, Cabou et Alençon, 1911.
(11) A. MAC COY, La Politique de l’héroïne en Asie du Sud-Est, Flammarion, Paris, 1980 (éd. angl. 1972).
(12) L. LEWIN, Phantastico, op. cit.
(13) J. LORRAIN, La Lanterne magique. Histoire de masques. Ollendorf. 1900.
(14) E. Bosc DE VEZE, De l’opium à la morphine, Bibliothèque des curiosités, 1908 (voir aussi Arnauld LIEDEKERKE, La Belle Époque de l’opium, Éditions La Différence, 1894).