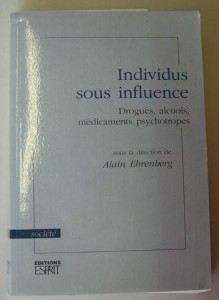- Auteur.e.s :
- Anne Coppel
- Robert Castel
- Alain Ehrenberg
Usages de drogues et processus d’auto-contrôle
« Les puissances qui nous portent à consentir » s’accordent sur une proposition quasi tautologique : la toxicomanie ne se peut contrôler. Le toxicomane est , pour le médecin, précisément celui qui n’est plus maitre de sa consommation. Figure de l’anomie, il est d’un point de vue sociologique, rejeté hors du champ du social de part les produits qu’il utilise autant que par l’usage qu’il en fait. Le glissement entre toxicomane ou pharmacodépendant et usager de drogues illicites qui fonde le consensus est entériné par le dispositif juridique qui ne fait, semble-t-il , que sanctionner la folle ambition d’échapper à la société des hommes. En écho, les toxicomanes témoignent à leur tour : l’illusion de la liberté les a égarés mille fois. Mais l’illusion se nourrit aussi de faits constatés.
Car les drogues illicites, y compris les drogues qui , comme les opiacés, engendrent une forte dépendance, n’échappent pas à la règle commune : elles sont, comme les psychotropes culturellement intégrés, en grande partie contrôlées, et ce, à différents niveaux, depuis l’abstinence jusque, et y compris, les consommations dépendantes. Il faut rappeler -fait social massif et mystérieussement ignoré -, que ceux qui expérimentent les drogues – ils seraient environ 25 % des 20-24 ans en région parisienne -, en abandonnent le plus souvent l’usage : la grande majorité, la drogue n’a rien d’irrésistible. Ceux-là même qui en font un usage occasionnel ne deviennent pas pour autant des toxicomanes. Les six millions de cocaïnomanes aux Etats-Unis sont loin d’être tous dépendants du produit. Il en est de même pour les opiacés Il existe bien des usagers occasionnels et même réguliers d’opiacés dont chaque génération de spécialistes signale l’existence, depuis les aliénistes du XIXème siècle au Dr Olievenstein.
Rien d’étonnant si les descriptions cliniques sont consacrées à ceux qui ne maitrisent pas leur consommation : les médecins répondent aux sollicitations de leurs patients. Vue du cabinet médical, la maladie se déroule inexorablement, de la lune de miel à l’ultime déchéance où le prisonnier de la drogue reconnait tout à la fois son mal et son impuissance. Le regard médical est si prégnant qu’il plonge dans l’obscurité l’expérience quotidienne de l’usager de drogues, d’abord confronté à la nécessité d’engendrer ses propres contrôles. La survie dans le monde de la drogue l’exige. Le contrôle ici commence par celui des quantités : se droguer, c’est d’abord apprendre à doser : se maintenir sur la ligne de crête exige une forte discipline. Le marché de la drogue est lui aussi affaire de contrôle. En dernière instance, il depend de l’usager-trafiquant et de sa capacité à contrôler sa propre consommation, évaluée au quotidien par ses clients comme par ses pourvoyeurs; et cette information qui tisse le marché de la drogue, circule au même titre que les arrivages, les qualités, les prix. La perte du contrôle est sanctionnée par l’exclusion des circuits de revente. Elle peut impliquer d’entrer plus avant dans la délinquance, les voleurs et les braqueurs étant souvent ceux qui ne parviennent pas à s’imposer de limites. Les toxicomanes peuvent aussi préférer recourir aux drogues légales, entrer en traitement, ou encore cesser de s’intoxiquer soit définivement soit pour revenir à un niveau de consommation mieux contrôlé.
Les toxicomanes dont les trajectoires ont été étudiées dans les pays anglo-saxons parfois sur plus de vingt ans, font ainsi alterner des périodes de consommations extrêmes, des périodes de stabilisation et des périodes d’abstinence volontaire et involontaire, la distinction étant parfois confuse, comme c’est parfois le cas lorsque l’emprisonnement est quasi recherché et vécu comme un soulagement. Il existe ainsi plusieurs modes de consommation, qui comprennent les fréquences et les quantités, m a i s aussi le type d’engagement dans le monde de la drogue défini par un système de relations, avec ses rituels et ses sanctions organisés autour de la prise de produit. Ou plus précisément par les mondes de la drogue : le drogué de la rue, le galérien des cités, le junky des bas-fonds, celui qui étincelle la nuit sur la Scène de New-York ou de Berlin « on the wilde side », l’employé, le golden boy ou le drogué « médical » peuvent parfois entrer en communication, ils n’en vivent pas moins dans des univers sociaux différents qui n’offrent pas les même possibilités de contrôle et de sorties (1). Parce que le déterminant n’est pas le produit, mais le rapport au produit et le mode de vie dans lequel il s’inscrit, selon les contextes, seront plus ou moins nombreux les usagers de drogues que Nurco baptise « competent » ou « sucessful addict » , et qui parviennent, grace à ce que le Dr Olievenstein qualifie « d’adaptation réussie aux effets du produits, fût-ce momentanément », à obtenir ce qu’ils recherchent, jouissance, apaisement, risque ou évasion, sans le payer du prix de leur liberté.
Le pari est difficile à tenir. Le toxicomane des services de soins est ainsi le perdant d’un jeu où le moindre faux pas peut être fatal. Zinberg qui a étudié ces usages contrôlé d »opiacés cite quelques exemples de consommations continue, parfois sur toute une vie, mais presque la moitié de ceux qui revendiquent le contrôle de leur consommation ont connu des périodes de consommation abusive aux quelles il leur a fallu mettre un terme (2). Les usagers de Zinberg ont choisi de poursuivre leur consommation d’héroïne mais les toxicomanes peuvent aussi renoncer à toute consommation, et c’est sans doute, à terme, le cas de la majorité.
Jusqu’à la fin des années soixante, la grande majorité des médecins considéraient que la toxicomanie comme une maladie quasi incurable. Expérience clinique et données épidémiologiques concouraient à ce pessimisme. Plus de 90% des toxicomanes hospitalisés à Lexington, un des principaux centre hospitalier des Etats-Unis, et suivis de 1952-53 d’abord sur 12 ans puis sur 20 ans, ont connu des rechutes. Quelques cas de cessation de drogues avaient bien été décrits, mais il a fallu attendre le retour des GI du Viet-Nam pour que la possibilité de cesser toute consommation d’héroïne y compris dépendante deviennent incontestable. Alors que 35% environ des GI’s avaient usé de l’héroïne et que 54% d’entre eux étaient devenus dépendants, les autorités militaires craignent le pire : le mal menace l’Amérique toute entière. De retour au pays, la très grande majorité -91% au bout de trois ans dans l’étude de Robin – y renoncent le plus souvent sans traitement : de bonnes conditions affectives et sociales se sont révélées suffisantes La prise d’héroïne, conjoncturelle, a cessé avec le changement de situation. Les études de trajectoires des toxicomanes incarcérés, celles de Nurco, Cesin et Balter sur 25 ans comme celles de Maddux et Desmond, ou encore les suivis des toxicomanes inscrits au registre du Home Office en Grande-Bretagne, évaluent à environ 25% après 5 ans et 40% après 10 ans les cessations de drogues (3).
Les mythes résistent vaillement aux faits. Le « Once addict, always addict » reste le credo commun aux toxicomanes et à l’opinion publique. Les croyances ont leur efficace : elles protègent le plus grand nombre de la tentation. Les toxicomanes, qu’elles confortent dans leurs habitudes, et leur entourage, en sont les seules victimes. Sortir de la drogue, devenir « comme tout le monde », c’est d’abord rompre avec les stéréotypes qui condamnent le toxicomane à le rester à vie. Soignants et soignés sont ainsi confrontés à un dilemne, résolu avec Narcotics Anonymes par exemple, avec le concept de « toxicomane abstinent ». Cette théorie offre plusieurs avantages. Au lieu de s’affronter en solitaire aux représentations collectives, le toxicomane en reconnait le poid; il s’avoue irrémédiablement vaincu par la puissance du produit; déculpabilisé, il garde en lui le souvenir de l’éternité, apprend à vivre avec le stigmate, et sans le produit.
Il est aussi des sorties de la drogue plus radicales en ce sens que l’usager de drogues refuse la marque indélébile et attribue aux consommations de drogues le sens d’un passage ou d’une errance momentanée, initiation au monde adulte, aventure ou période de dépression. Ces sorties, qui sont sans doute les plus fréquentes, échappent au clinicien comme au chercheur : elles sont d’autant plus efficaces que le sujet se distancie du monde de la drogue au présent mais aussi parfois au passé : la consommation de drogues n’est pas ou n’est plus investie de significations culturelles. Rétrospectivement, la preuve est faite que le sujet « n’a jamais été toxicomane ».
Construit sur un système de double contrainte qui exige tout à la fois de reconnaitre la toute puissance de la drogue et d’en contrôler les effets, le monde de la drogue condamnerait à terme l’usager de drogues à la toxicomanie, « transformation d’une expérience, même auto-destructrice, mais vivante, en entreprise mortifère de dépendance généralisée, unilinéaire » et dont Deleuze se demande si elle est « inévitable » (4). De fait, et c’est là un des enseignements de la recherche de Zinberg, tous ceux qui revendiquent un contrôle de l’usage se démarquent explicitement du monde de la drogue. Certains limitent leurs relations aux autres usagers à la transaction commerciale, la plupart maintiennent volontairement des liens sociaux ou affectifs avec des milieux étrangers à la drogue. Tous doivent intégrer, à un titre ou à un autre, les interdits à la fois légaux et sociaux. La consommation est ainsi limitée soit parce qu’elle doit être tenue secrète soit parce que l’usager se refuse à déséquilibrer son budget, ou encore qu’il s’impose de n’effectuer aucune démarche volontaire dans les lieux de trafic et de consommation. Les auto-contrôles sont pour une part l’intériorisation des contrôles sociaux et légaux des drogues illicites, chaque usager privilégiant, selon ses moyens et ses aspirations un aspect ou un autre des hétéro- contrôles (5).
Des régulations sociétales à une politique de contrôle des toxicomanies
Ces stratégies de distanciation ou désengagement sont d’abord des réponses individuelles. Elles peuvent aussi se cristalliser en comportements collectifs qui signent la fin des épidémies de drogues. Car les épidémies de drogues sont mortelles. Entre 1970-71 et 1975-76, Harlem a ainsi connu une accalmie qui est restée quasi invisible (6). En cinq ans, le nombre de ceux qui ont consommé de l’héroïne occasionnellement ou continument est passé de 24% pour ceux qui sont nés en 1952 à 3% pour ceux qui sont nés en 1957; et cela alors que le produit restait largement accessible, d’excellente qualité et moins cher que dans n’importe quelle ville américaine. Tandis que dans les esprits, l’héroïne restait le dragon invisible auquel nul ne peut resister, les habitants de Harleme se sont dépris du produit, et les héroïnomanes ont, dans leur grande majorité, cessé de s’intoxiquer; à l’héroïne du moins, la marijuana et la cocaïne étant consommée de plus en plus largement, préparant de fait l’arrivée du crack.
La France a connu de ces vagues successives. L’opium juste et subtil de De Quincey est pour Baudelaire qui le traduit, le tribut du génie tourmenté à sa folle ambition. Aux côté des conquérants de l’Asie, Ségalen, Loti, Farère y voient « l’oubli du passé, le dédain du présent et l’indifférence du futur », la clé de la pensée orientale qui ouvre à l’ailleurs, à l’exotisme, et au travers de l’autre, à la découverte de soi-même. Quelques vingt ans plus tard, l’opium d’Artaud n’est plus qu’une « médecine miséricordieuse aux évadés de l’enfer ». En celà, Artaud partage le sentiment des surréalistes. Objet de fascination trouble depuis les romantiques, l’opium a changé de signification sociale, il est devenu synonyme de mort et les surréalistes débattent du suicide, non de la drogue. Rompant avec Crevel, Rigaut, Artaud,ou encore, Daumal et Gilbert-Lecomte, « ceux qui sont du côté de la vie » s’engagent dans la lutte politique. Pour quelque 40 ans, artistes et intellectuels se désintéressent de la question qui a été tranchée sans avoir été débattue.
Le cannabis vient de subir sous nos yeux un cycle analogue qui va de la fascination à l’indifférence, ou pour reprendre le terme consacré, à sa banalisation. A l’aube de sa diffusion dans les pays occidentaux, la marijuana exige une initiation. « Pour devenir un usager de marijuana », il faut observe Becker, être « initié », c’est à dire changer tout à la fois de cadre de perception et cadre d’interprétation (7). Fumer, c’est, par exemple, apprendre à se situer hors du temps, ici et maintenant, dans l’éternité du moment. C’est ainsi rejeter les normes qui régissent la société industrielle, et le joint accompagne, dans les pays anglo-saxons, la contestation des années 60. Attaqués, les pays occidentaux s’arment contre l’ennemi qui rend fou : des cas cliniques l’attestent.
Curieusement, c’est précisément le moment où le nombre des consommateurs s’élargit, tout au long des années soixante, que la menace cesse d’être prise au sérieux. En 1976, Monique Pelletier annonce officiellement la fin des hostilités. La consommation de cannabis reste une trangression mais la circulaire de 1978 recommande d’éviter la pénalisation de la consommation. La tolérance, indifférente ou amusée, l’emporte ; chez les esprits forts du moins. Au début des années 80, le cannabis est « banalisé », dit-on, mais paradoxalement, cette banalisation s’accompagne, semble-t-il, d’une relative stabilisation. Même si les consommations de cannabis perdurent, elles ont perdu de leur aura. Les jeunes peuvent l’expérimenter; ils en connaisent les avantages, mais aussi les inconvénients : le cannabis s’accomode mal des contraintes de la vie citadine, et il faut aujourd’hui être rapide, efficace et organisé. Ceux-là même qui en avaient prôné les vertus, l’ont souvent abandonné, quasi spontanément, comme l’observe Aud qui a étudié le changment de significations sociales du cannabis au cours des années soixante-dix : « J’ai beaucoup aimé fumer, je n’y pense p^lus guère; autour de moi, personne ne fume et j’ai peu de temps à moi » dit, par exemple, un de ces anciens consommateurs »(8). Le pragmatisme l’emporte. Pour Aud, il participe de ce qu’il nomme les « social contrôls » des produits psychotropes qu’il conviendrait de traduire par contrôles sociétaux dans la mesure ou il s’agit de contrôles informels qui ne sont du reste pas vécus comme des contrôles mais comme le choix d’un désinvestissement.
Lorsque Zinberg et Harris regroupent, pour le Drug Council en 1973, puis pour le NIDA, les anthropologues susceptibles de décrire les usages sociaux des drogues, leur démarche est opérationnelle (10). Le constat de départ est celui d’un échec des politiques d’éradication. Bon gré, mal gré, les drogues illictes se sont introduites dans notre société, et de fait, il nous faut apprendre à les cotoyer.
Ces stratégies de prévention sont aujourd’hui adoptées au niveau des campagnes nationales dans le domaines des psychotropes licites. Les choix effectués – abstinence ou modération -, reposent sur des études d’opinion, confrontées à une connaisance des différents comportements face au produit. Dans la lutte anti-tabagique, le refus du tabac l’emporte et les non- fumeurs ont été identifiés comme ressources mobilisables. Pour l’alcool, le parti adopté est celui de la modération. Le slogan « Un verre ça va, trois verre, bonjour les dégâts » adopte une morale pragmatique qui fait consensus; et le ton est suffisamment plaisant pour que le slogan puisse être repris dans les interactions quotidiennes : il permet, par exemple, de refuser un verre sans rompre avec les règles de sociabilité qui accompagne la consommation d’alcool.
Dans le domaine des drogues illictes, le choix de la modération est inenvisageable : « Un joint, ça va, trois joints, bonjour les dégâts » heurte de plein fouet le sentiment général. Outre qu’un tel slogan peut être incriminé d’incitation à la consommation de drogues illicites, la guerre à la drogue fait consensus. Le « non » à la drogue renforce ceux, largement majoritaires, qui en refusent l’usage. On sait aussi qu’il a peu de prise sur ceux qui ont trangressé cette première barrière.
Dans les milieux où les drogues illicites sont facilement accesssibles, des stratégies spécifiques doivent être élaborées au plus près du terrain. Ces stratégies doivent procéder des mêmes principes que les campagnes nationales : identifier « les ressources mobilisables », à savoir les façons de dire et les façons de faire qui contribuent à un contrôle de l’abus de drogues. Les drogues illicites ont engendré des univers culturels auxquels nous ont initié, plus que les ethnologues, les artistes, poètes, cinéastes, musiciens. Qu’ils soient dominés par des puissances occultes ou par le Chaos, ces mondes à la dérive sont à mille lieux des logiques rationnelles de la santé publique. Ils secrètent néanmoins dans leur sein mais aussi dans leur environnement proche, et en réaction, des pratiques de protection où peuvent s’ancrer des politiques actives de prévention. Le monde du spectacle comme celui du show-bizz ont ainsi tiré des enseignements depuis l’épidémie des années soixante, et le contrôle s’exerce non pas sur le produit, mais en fonction des impératifs qui sont ceux des réalisations. Y compris dans les quartiers les plus démunis, s’expérimentent au quotidien de nouveaux comportements qui permettent de faire face : ce sont les plus jeunes qui apprennent à déjouer les pièges dans lesquels sont tombés les ainés, c’est la famille qui peu à peu parvient à éviter de renforcer, par la dramatisation, les comportements les plus marginalisants; c’est afin les usagers eux-mêmes qui doivent, au-delà des stéréotypes, retrouver le contrôle d’eux-mêmes.
Dans la guerre contre la drogue, des batailles ont été gagnées, sans les armes, ou plutôt à côté des armes qui sont celles de la guerre à la drogue, et les épidémies de drogues disparaissent mieux semble-t-il, dans l’indifférence générale. Faut-il pour autant renoncer à toute intervention ? Le dilemne n’est pas spécifique à la drogue. Face à l’adversité, les pauvres parviennent parfois à bricoler des réponses mieux adaptées que les dispositifs sociaux. Ces bricolages, dans la pauvreté comme dans la drogue, ont leurs limites; leur efficacité s’inscrit dans des temporalités – celles des grands changements sociaux -, qui sont loin de répondre à nos exigences en matière de protection sanitaire et sociale. Peu à peu, se réduisent, en grande partie spontanément, les modes d’alcoolisation qui ont accompagné l’industrialisation mais il aura fallu presque deux siècles pour commencer à contenir l’épidémie majeure de notre société, au prix d’une souffrance qui ne peut guère se chiffrer.
Entre l’ambition folle de se substituer radicalement aux réponses sociétales et le renoncement à toute action volontaire de la société sur elle- même, il existe un moyen terme : une action en complémentarité des réponses sociétales, et au sein même des pouvoirs publics, des différentes logiques qui prétendent à un contrôle de l’abus de drogues. A ce jour, aucune logique, qu’elle soit médicale, législative, sociale ou sociétale, n’a pu imposer durablement son hégémonie. Au regard d’une volonté d éradication, l’échec est patent, ce qui signifie nullement qu’elles soient impuissantes.. Il y une efficacité incontestable des contrôles, qu’ils soient sanitaires – telle la politique de santé publique menée dans l’ Angleterre du XIXème siècle contre l’épidémie d’opium -, législatifs- en termes de santé publique, la prohibition de l’alcool aux USA a obtenu des résultats sensibles : diminution de la pathologie associée à l’alcool -, sociaux et sociétaux – voir les exemples de mobilisation communautaire dans les ghettos aux Etats- Unis (10). Une politique plus efficiente passe, nous semble-t-il, par une réflexion approfondie des contrôles existants et leur champ d’application, qui doit permettre de rapprocher dispositifs et stratégies d’intervention des pratiques effectives, et de limiter, autant que faire se peut, par la multiplicité des approches, leurs effets indésirables.
Notes :
1. Sur différentes approches anthroplogiques des consomations de drogues selon les communautés d’appartenance et leurs évolutions récentes,, voir HANSON/BESCHER (Ed.), 1985, Life with Heroin, Lexington Books, D.C. Heath and Company/Lexington, Massachusetts/Toronto; pour une typologie des modes de consommation de l’héroïne aux USA, voir FLAHERTY E.W., KTRANSKI L., FOX E., 1984, « Frequency of Heroin Use and Drug Users’ Life- Style, » Am.j. Drug Alcohol Abuse, 10(2)
2. ZINBERG Norman E., 1984, Drug, Set, and Setting, the Basis for Controlled Intoxicant Use, Yale University Press, New Haven and London; voir aussi le numéro spécial de Journal Of Drug Abuse , The Recrational and Social Uses of Dependency-producting Drugs in Diverse Social and Cultural Contexts, printemps 1980;
3. Sur les études de trajectoires aux Etats-Unis, voir par exemple WALDORF, D., 1973, Careers in Dope, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall; en Grande- Bretagne, STIMSON Gerry V., OPPENHEIMER Edna, 1982, Heroin Addiction, Treatment and Control in Britain, Tavistock Publications, London and New York
4. CHATELET F., DELEUZE G., GENEVOIS E., GUATTARI F., INGOLD R., MURARD N., OLIEVENSTEIN, 1978, Où il est question de toxicomanie, Bibliothèque des mots perdus.
5. HILLIKER James K., GRUPP Stanley E., SCHMITT Raymond L., 1981, « Adult Marijuana Use and Becker’s Social Controls », The Intern.. J. of the Add., 16(6), 1031-1047;
6. BOYLE J. M., BRUNSWICK A. F.,,1980 : »What happened in Harlem ? Analysis of a decline in heroin use among a generation of urban black youth », Jour. of Drug Issues, Winter, 109-130.
7. BECKER Howard,1963, « How to Become a Marijuana User », in Outsiders,Studies in the Sociology of Deviance, New York, Free Press; voir aussi YOUNG Jock, 1976, The Drugtakers : The Social Meaning of Drug Use, London Paladin.
8. AUD John, 1981, Marijuana Use and Social Control, Academic Press, London, New York, Toronto, Sudney, San Francisco
9. ZINBERG N.E. and HARDING W.M., 1982, Control over Intoxicant Use; Pharmacologicaln, Psychological and Social Consideration, Ed. New York, et particulièrement l’article de MALOFF D., BECKER H.S., FONAROFF A. and RODIN J., 1982, « Informal Social Controls and their Influence on Substance Use »; JACOBSON R.C. and ZINBERG N.E., 1975, The Social Basis of Drug Abuse Prevention, Drug Abuse Council Publication, n° SS-5, Washington D.C., The Drug Abuse Council, Inc.
10. HUGHES P. H., 1980, « U.S.A. : Community Treatment to Reduce Demand for Illicit Heroin », in Drug Problems in the Sociocultural Context : A Basis for Policies and Programme Planning, EDWARD G. and ARIF A. (Ed)), WHO, trad. franç. 1982; pour une articulation entre mobilisation communautaire et traitement à la méthadone, voir HUGHUES Patrick H., 1977, Behind the Wall of Respect Community Experiments in Heroïn Addiction Control, The University Press of Chicago, Chicago et Londres. Pour une réfexion sur les différents modes de contrôle de l’héroïne, KAPLAN John, 1983, The Hardest Drug, Heroin and Public Policy, The Chicago University Press, Chicago et Londres; pour une approche générale des modes de controles des psychotropes, BALAKAR James B. and GRINSPOON Lester, 1984, Drug Control in a Free Society, Cambridge Univesity Press, Cambridge, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney.