- Auteur.e.s :
- Anne Coppel
- Renaud Colson
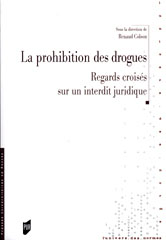
La réduction des risques liés à l’usage de drogues,
La réduction des risques liée à l’usage de drogues doit-elle être considérée comme un changement de la politique des drogues ou bien n’était-elle que la version sanitaire de la politique française des drogues ? Officiellement, c’est la continuité de la politique qui est revendiquée ; programmes d’échange de seringues, “ boutiques ” qui accueillent les usagers de drogues sans exiger qu’ils soient sevrés ou même testing des drogues de synthèse dans les raves et free-parties ont été ajoutés au dispositif existant au titre de la prévention du sida. Quant aux traitements de substitution, ils ont acquis le statut de traitement de la dépendance ; quelque 92 000 patients sont actuellement en traitement, dont 12 000 avec méthadone et 80 000 avec un nouveau médicament, le Subutex. Or ce dispositif a obtenu des résultats étonnants : réduction de 80% de la mortalité par overdoses, réduction de 67% des interpellations pour usage d’héroïne, tels sont les principaux résultats obtenus entre 1994 et 1999 dont une évaluation nationale montre qu’ils ne sont pas dus à une baisse spontanée de la consommation d’héroïne ; il y a bien une corrélation entre l’accès au traitement et l’amélioration de la santé, de la baisse de la mortalité à la baisse des contaminations par le sida (1). Sans ces résultats, ce dispositif n’aurait pas été maintenu, ni par le gouvernement précédent, de gauche, ni par le gouvernement actuel ; car ce dispositif ne va pas seulement à l’encontre des croyances collectives ; il est contraire à la loi de 1970 qui pénalise l’usage de drogues. On ne peut à la fois distribuer des seringues et interdire aux usagers de s’en servir : c’est là une évidence qui a d’ailleurs été un obstacle majeur à la mise en place de ces mesures. Aussi celles-ci ont eu d’abord un statut expérimental, justifié par l’urgence du sida. Compte-tenu de ses résultats, le dispositif a acquis un statut officiel en 1999 au titre de la prévention du sida, la contradiction avec la loi de 1970 n’étant toujours pas résolue. Convaincus a priori que la politique du gouvernement précédent, de gauche, était laxiste, les sénateurs ont mené l’enquête en 2001 ; à leur tour, ils découvrent ces résultats qui ne pouvaient être contestés (2). Aussi ont-ils proposé que ce dispositif acquiert un statut légal dans le cadre de la loi de santé publique au titre de la lutte contre les maladies infectieuses. Comment expliquer que la lutte contre le sida ait pu obtenir une baisse nationale aussi rapide de la mortalité ? Quel rapport y a-t-il entre le sida et la baisse des interpellations pour usage ? En quoi le testing des drogues de synthèse contribue-t-il à la prévention du sida ? Voilà qui n’a rien d’évident ; le testing reste d’ailleurs l’outil le plus contesté et cependant, il s’inscrit dans la même logique que “ le shoot à moindre risque ” ou encore “ le snif propre ” ; il réduit les risques en informant l’usager de la nature du produit qu’il consomme.
Pour les spécialistes en toxicomanie, il s’agit là d’un changement radical des pratiques habituelles qui est aussi un bouleversement de leurs croyances ; désormais, la prévention ne se limite pas au “ non à la drogue ” ;” elle doit aussi s’adresser à ceux qui expérimentent des drogues illicites afin que leurs choix soient informés. C’est là ce qui se pratique depuis toujours dans la prévention de l’alcool et du tabac. Aussi l’alcool et du tabac ont-ils été intégrés dans le dispositif de lutte contre la toxicomanie – autre révolution dans les esprits ; autre contradiction avec le cadre législatif qui, au-delà de la pénalisation de l’usage, remet en cause le statut licite ou illicite des produits.
Ce nouveau statut de l’alcool, devenue drogue légale, allait-il être remise en cause avec le changement de gouvernement ? La question taraudait quelques journalistes. “ Rien ne sera changé de la politique des drogues ” leur a-t-il été répondu. La réponse semblait difficilement crédible. Le gouvernement de gauche ayant affiché une politique de prévention, ce gouvernement, de droite, se devait de prendre des mesures répressives. Avec les lois Sarkozy, les mesures répressives se sont effectivement affichées sans pour autant que la prévention soit abandonnée ; celle-ci au contraire prend un nouveau visage, loin des représentations qui, en France, assimilent volontiers “ prévention ” et “ laxisme ”. Tabac ou cannabis, la santé publique est invoquée avec une véhémence nouvelle. D’une certaine façon, il s’agit là d’un retour aux sources ; officiellement, la lutte contre la drogue se mène au nom de la santé publique mais à vrai dire, la protection de la santé avait été quelque peu oubliée. L’épidémie de sida et le scandale du sang contaminé, mais aussi, avec la vache folle comme avec l’amiante, une nouvelle prise en compte de l’environnement ont contribué à ce retour en force de la santé publique, mais cette nouvelle demande sociale est-elle purement rationnelle ? N’était-elle pas encore une fois le masque d’une morale hygiéniste, l’autorité médicale se substituant aux autorités religieuses dans l’imposition d’un ordre moral ? Quelles sont enfin les conséquences sur les politiques de drogues de ce retour en force de la santé publique ?
Ce retour n’est pas propre à la France ; dans le domaine des drogues, il est à l’origine d’expérimentations de terrain telles les salles d’injection, les prescriptions médicalisées d’héroïne ou même, aujourd’hui en Suisse, de stimulants, en substitution à la cocaïne et autres psycho-stimulants. S’agit-il d’un changement des politiques de drogue ou bien doit-on considérer que ces expérimentations ne font que développer les réponses médicales inscrites dans les dispositifs prohibitionnistes comme alternatives à la répression ? Pour comprendre quels sont les enjeux de ces nouvelles approches, nous nous attacherons dans cet article à analyser la construction du débat public, à l’origine du consensus français sur la guerre à la drogue ; nous indiquerons ensuite quelles lignes de force ont contribué à fracturer cet apparent consensus pour aboutir à ces nouvelles problématiques et quels ont été les résultats obtenus. Nous analyserons enfin les contradictions auxquelles se heurtent ces expérimentations de terrain pour acquérir un statut juridique en France mais aussi en Europe ; soit le plan suivant : 1°) La construction du consensus politique sur la guerre à la drogue : le compromis historique entre conservateurs et libéraux 2°) “ La médicalisation des toxicomanes ” à l’épreuve du sida. 3°) La méthadone est-elle une drogue ou un médicament ? 4°) La réduction des risques, une politique de santé publique fondée sur la responsabilité. 5°) Où la santé publique retrouve ses droits.
La guerre à la drogue est la politique officielle des Nations Unies et pour le moment, aucun pays ne s’y est opposé. Le consensus de la classe politique sur la guerre à la drogue n’est pas étonnant ; la France a toutefois une histoire particulière, à l’origine du tabou qui a longtemps interdit tout débat public. Le débat public en effet est construit sur un compromis historique entre conservateurs et libéraux qui s’est scellé sous la présidence de Giscard d’Estaing en 1978. La loi de 1970 avait été votée deux ans après 1968 par des parlementaires qui entendaient rétablir l’ordre public. “ Le fléau de la drogue ” était considéré comme symbolique des dérives du libéralisme en matière de mœurs, démontrant par là même ses limites en matière économique. Ministre de l’intérieur, Marcellin, avait exigé la pénalisation de l’usage de drogue ; les experts, consultés par le Ministre de la santé y étaient tout d’abord opposés; la mesure est finalement acceptée parce que les médecins ont obtenu une garantie essentielle : grâce à l’anonymat, la Justice ne peut exercer aucun contrôle sur leurs pratiques. Car si la loi de 1970 propose le traitement comme alternative à l’incarcération, pour les experts, le traitement médical n’a pas de justification. La consommation de drogues témoin de “ la crise des valeurs ” et ou encore, pour les jeunes, de la crise d’adolescence est d’abord un problème de société.En 1978, un rapport officiel, le rapport Pelletier, pose les questions clés : la sévérité de la loi de 1970 est-elle justifiée ? Le fléau de la drogue est-il une menace qu’il faut prendre au sérieux ? Menace-t-il la Santé publique ? La répression est-elle efficace face à la toxicomanie ? Les réponses sont sans équivoque : c’est non. Si la société a peur, c’est que le toxicomane remet en cause les valeurs d’effort, de travail et de réussite. Les experts consultés sont unanimes : la toxicomanie n’est pas un problème de santé publique, le toxicomane n’est pas un malade. Pour Monique Pelletier, le jeune qui consomme du cannabis serait plutôt un déviant ; ni la prison ni le traitement médical ne sont justifiés ; toutefois, ajoute-t-elle, la loi ne peut être abolie dans l’immédiat: elle rassure une opinion désorientée par la contestation(3). Le consensus doit être reconstruit au nom des valeurs communes aux conservateurs et aux libéraux qui fondent l’ordre républicain. Tandis que les conservateurs dénoncent le fléau, les libéraux sont persuadés que ce catastrophisme est d’abord la peur du changement mais désormais, le dissensus est masqué. Les uns et les autres s’accordent sur un message politique qui se doit d’être rassurant : “ Ne vous inquiétez pas, le gouvernement fait ce qu’il faut ; il s’engage pleinement dans la lutte contre le fléau ”. Ce message en direction de l’opinion publique se dédouble d’un message qui se veut tout aussi rassurant en direction de l’opinion éclairée : “ Ne vous inquiétez, la lutte est purement symbolique ; elle n’a pas d’autre fonction que de restaurer l’autorité de l’Etat ”.- ou encore, dans une version éducative, de marquer une limite. Rassurée par le rapport Pelletier qui démontrait que les experts et les décideurs n’étaient pas dupes, l’opinion éclairée, a priori attachée aux libertés individuelles, a compris qu’elle n’avait aucun intérêt à mettre en doute la réalité du fléau ou l’efficacité des armes, répression ou prévention. La liberté de se droguer ne pouvant se revendiquer, la question des drogues a été mise de côté, abandonnée aux peurs populaires et à la démagogie. Le rapport Pelletier avait bien préconisé d’opposer aux peurs irrationnelles une information objective, mais les décideurs tirent une toute autre conclusion : puisque, selon les experts, il n’y a pas de véritable problème de santé publique, il n’y a pas de nécessité à mettre en place une politique ambitieuse de santé, soins ou prévention. Ainsi les conservateurs parviennent-ils à imposer l’alternative “ répression ” ou “ laxisme ” dans le débat, les libéraux pouvant difficilement revendiquer publiquement qu’il n’y a pas d’urgence à agir. Il faut se souvenir qu’en 1978, le cannabis progresse mais l’épidémie d’héroïne est presque invisible ; quelques milliers au plus, évaluent les experts. Effet pervers de ce diagnostic, l’absence d’études épidémiologiques ; dans les années 80, l’épidémie d’héroïne est juste une rumeur, interprétée comme “ sentiment d’insécurité ”. Il faut attendre le rapport Henrion en 1994 pour que les conséquences de l’épidémie de sida commencent à être prises en compte. “ Moins on en parle, moins on y pense et mieux on se porte puisque dès qu’on en parle, il faut hurler avec les loups ”, tel a été longtemps l’unique bréviaire du parti socialiste mais aussi d’une bonne part de la classe politique à droite. Le double discours est sans aucun doute la position la plus difficile à assumer ; tandis que la peur progresse dans l’opinion, la classe politique se débat pendant les années 80 : l’insécurité doit-elle être prise au sérieux ou bien s’agit-il seulement d’un “ sentiment d’insécurité ” ? Le gouvernement de Chirac de 1986 marque un tournant ; avec son Ministre de la Justice, Chalandon, ce gouvernement tente – en vain- d’appliquer la loi de 1970. Il y aurait selon le Ministre de la justice 500 000 toxicomanes, à soigner ou à incarcérer ; les spécialistes refusent les traitements obligatoires au nom de l’éthique mais dans le débat public, la loi de 1970 n’est pas remise en cause. Il faudra attendre la proposition de loi de Nicolas Sarkozy en 2002 pour que l’évidence soit dite : la loi de 1970 n’est pas applicable.1986-1987 est aussi l’année où la réalité des risques sanitaires commence à être prise en compte. En 1987, Michèle Barzach met les seringues en vente libre. C’est la première mesure qui réponde à une exigence de santé publique et en 1987, l’exigence se limite au sida. Encore a-t-il fallu à Michèle Barzach le courage de s’affronter à l’opinion, à son parti politique et enfin au corps médical, persuadé que la question des drogues ne les concerne pas : elle relèverait uniquement d’un débat de société.
Si selon les médecins, la toxicomanie n’est pas une maladie, pourquoi la loi impose-t-elle un traitement ? À quoi tient cette demande faite aux médecins ? En ce début des années 70, un ensemble de travaux décrypte la fonction normative de la médecine : les médecins exercent une nouvelle forme de pouvoir dont la fonction est de légitimer les normes sociales (4). Pour Thomas Szasz, psychiatre libéral américain, les médecins sont devenus les grands prêtres d’aujourd’hui, une véritable religion d’Etat : “ la guerre à la drogue est une guerre sainte ” “ pour la plus grande gloire de l’Etat Thérapeutique ”. C’est désormais “ au nom de la Science que la lutte est menée contre le Mal ”(5). Pour le Pr. Olievenstein comme pour les premiers spécialistes, ni la transgression, ni l’errance ou la détresse ne doivent être médicalisées. Si la loi de 1970 est inscrite dans le code de santé publique, personne à l’époque ne voit la nécessité d’appliquer à cette question les méthodes et les concepts de la santé publique ; au reste, il y a alors peu d’experts de ce champ, la France privilégiant la réponse thérapeutique au détriment de la prévention et de la santé publique. L’affaire du sang contaminé est l’héritière d’une “ défaite de la santé publique ” qui remonte à ses origines (6). Elle a contraint les décideurs à une démarche d’expertise qui n’avait pas été jugée utile précédemment. Entre 1993 et 1994, un débat public s’ouvre sur la question des drogues, provoqué en bonne part par la menace du sida. La pénalisation de l’usage est au cœur du débat et c’est bien la question de la loi que Simone Veil, alors ministre d’Etat pose à une commission officielle, la commission Henrion. La réponse est largement décalée :la commission ne parvient pas à obtenir un consensus sur la dépénalisation de l’usage ; par contre elle recommande des mesures de santé publique face à l’épidémie de sida (7). Les médias n’ont pas attaché d’importance à cette recommandation, le débat public portant exclusivement sur la loi. Ils n’ont pas rendu compte en particulier du diagnostic auquel cette commission a abouti, après une année et demie d’enquête – à savoir la situation catastrophique des toxicomanes tant au niveau sanitaire qu’au niveau social. “ Catastrophe ” : le mot est violent, il va à l’encontre du discours rassurant tenu habituellement par les pouvoirs publics. C’est aussi que traditionnellement en France, seuls les partisans de la répression alertent l’opinion face au “ fléau ”. L’opinion éclairée, informée par les experts, refuse de “ dramatiser ”, l’expérience montrant que la peur conduit à renforcer la répression ; face au sida, la peur pourrait aboutir à des “ sidatoriums ” que réclament les partisans de l’extrême-droite. Résultat, les Français n’ont pas été informés de la gravité de l’épidémie de sida. Faute d’études épidémiologiques, la mortalité des toxicomanes n’est pas connue à l’exception des overdoses comptabilisées sur la voie publique. À l’hôpital ou à au domicile, les toxicomanes ne meurent pas d’overdoses mais par exemple, d’arrêt cardiaque. Dans le système de soins spécialisés, la catastrophe sanitaire – car catastrophe il y a bien – est invisible ; seuls sont admis ceux qui peuvent “ formuler une demande ” et suivre une psychothérapie. L’hôpital général refuse ces malades orientés systématiquement vers les centres spécialisés. Y compris dans les services spécialisés dans le sida, les toxicomanes sont longtemps très minoritaires. Il faudra attendre les traitements de substitution pour qu’ils apparaissent brusquement dans les hôpitaux comme en médecine générale.Il aura fallu la commission Henrion pour qu’une commission officielle pose une question redoutable, qui, depuis le rapport Pelletier, avait tout simplement été mise de côté : quelle est la réalité du risque ? En 1994, il s’agit uniquement du risque infectieux ; en 1999, la santé publique ne se limite plus au sida ; elle est convoquée aussi bien dans la prévention que dans le soin aux usagers de drogues. Invocation rituelle en 1970, la santé publique fait aujourd’hui un retour en force. Ce n’est pas dire qu’elle ne puisse, comme hier, être utilisée dans une perspective morale ou hygiéniste ; du moins passe-t-on d’un modèle légitimé par une autorité qui ne doit pas être contestée à un modèle qui fait appel à la rationalité scientifique. Les choix peuvent donc être discutés ; encore faut-il souhaiter cette discussion et s’en donner les moyens.
C’est par cette question que s’est ouvert le débat sur la réduction des risques ; or la différence entre drogue et médicament, c’est ce qu’en font les toxicomanes. Les drogués, on le sait, veulent de la drogue. En 1992 quelques héroïnomanes se regroupent dans une association, ASUD, association d’auto-support des usagers de drogues. C’est la première association française à regrouper des usagers de drogues – qui se droguent. Cette association, dans le sillage de la lutte internationale contre le sida, demande que les usagers de drogues aient accès à des seringues stériles ; elle demande également de la méthadone, à défaut de prescriptions de morphine ou même d’héroïne. Pour autant, les usagers français refusent de se considérer comme des malades ; ce qu’ils veulent, c’est le produit. C’est faire du médecin un dealer et c’est justement ce que refuse le corps médical. La toxicomanie n’étant pas une maladie, la prescription médicale ne pouvait se justifier ; elle revenait à “ donner de la drogue aux drogués ”. Pour les médecins français les mieux informés, la méthadone n’est qu’un outil de contrôle social ; elle n’aurait pas d’autre but que “ protéger le cœur des cités bourgeoises ”, tout en renonçant à traiter “ les véritables causes de la toxicomanie ”, c’est-à-dire la souffrance psychique (8). Ce système de croyances présentait l’avantage de protéger le corps médical de ces patients encombrants et cette protection était renforcée par une législation punissant sévèrement les médecins, faibles ou complices, qui n’avaient pas intégré ce qui était considéré comme “ l’éthique médicale ”. Bien sûr, les médecins français savaient qu’ailleurs, la méthadone était considérée comme un traitement mais les travaux épidémiologiques, cliniques ou scientifiques n’étaient pas connus ; pour les Français, il était aussi absurde de s’informer de leurs résultats que de lire les travaux des psychiatres russes qui justifiaient la prescription de neuroleptiques aux opposants du régime. De 1992, date où s’ouvre le débat public à 1996 où la méthadone et le Subutex sont mis en vente avec le statut de médicament, les croyances collectives s’effondrent ; un argumentaire scientifique fondé sur les neurosciences justifie désormais les traitements de substitution mais pour intégrer cet argumentaire international, les praticiens ont dû d’abord expérimenter par eux- mêmes l’utilité de ces prescriptions. Les pionniers qui ont accepté de prescrire ont pu constater par eux-mêmes que ces prescriptions avaient des effets bénéfiques avec pour premier résultat, l’amélioration de la relation avec ces nouveaux patients. Ni les uns ni les autres n’ont changé d’abord de croyances, mais héroïnomanes et médecins ont pu entrer en relation avec un objectif commun : “ aller mieux ”. Le médicament est une drogue si le toxicomane parvient à soutirer le produit au médecin et qu’il ne rend pas compte de l’usage qu’il en fait. La drogue devient médicament si le médecin s’introduit en tiers dans la relation du toxicomane à son produit. Tandis que des médecins ont accepté les usagers de drogue tels qu’ils étaient, à savoir consommateurs de drogues, ces nouveaux patients ont accepté de rendre au compte au médecin, parce qu’ils ont pu le faire sans pour autant se renier. Entre temps, les uns et les autres ont appris que la dépendance à l’héroïne n’était pas qu’une affaire de bonne ou de mauvaise volonté, qu’il y a des processus neurobiologiques à l’œuvre, ce qui n’est pas pour autant faire du toxicomane un esclave qui aurait perdu toute liberté.Dans le débat public sur les traitements de substitution, un acteur avait été oublié, l’usager. Il en est de la prescription médicale pour la dépendance à l’héroïne comme il en est de la prescription d’anti-dépresseurs. Selon un sondage anglais, 80% des personnes sont persuadées que le véritable traitement de la dépression est la psychothérapie mais 3% seulement des personnes déprimées y auraient recours, tandis qu’environ 1/3 choisit le médicament (9). La différence entre le traitement de substitution à l’héroïne et la médicalisation de la dépression est que les usagers de drogues n’avaient pas le choix de la stratégie thérapeutique. Dès que la prescription a été accessible, les usagers d’héroïne s’en sont emparés. Le Subutex dont les dérives sont dénoncées aujourd’hui est-il devenu une drogue ? Sans doute, le produit est-il accessible sur le marché noir ; sans doute il y a des médecins qui n’ont pas su instaurer une relation thérapeutique mais contrairement à ce qui se dit, il s’agit là d’une minorité. Si le Subutex était seulement une drogue, il n’y aurait eu ni baisse de la mortalité ni baisse de la délinquance. L’accès large aux soins a été la condition de la réussite ; des mesures de contrôle sont certainement nécessaires, mais elles doivent préserver la qualité de la relation clinique, car c’est dans cette relation que la drogue, domestiquée, devient médicament.
Le changement des croyances est passé par un changement des relations entre les médecins prescripteurs et les usagers d’héroïne. Au cours des années 80, les prescriptions médicales illégales sont expérimentées par des médecins isolés. 1992 marque un tournant : la réduction des risques liée à l’usage de drogue, expérimentée dans le mouvement international de lutte contre le sida, s’introduit en France. Cette politique de santé publique a été instaurée en Grande-Bretagne dès 1987, les principes qui la fondent sont ceux qui régissent la prévention du sida, le premier d’entre eux étant la responsabilité individuelle. Face au sida, en effet, les homosexuels ont rapidement adopté le préservatif mais pouvait-on faire appel à la responsabilité des héroïnomanes ? Voilà qui semblait a priori peu vraisemblable or dès 1986, une étude menée à New York auprès des héroïnomanes de rue montrent que 60% avait adopté la seringue personnelle. Il n’y aurait pas eu de réduction des risques si les héroïnomanes n’avaient apporté la preuve qu’ils pouvaient protéger leur santé (10). Cette nouvelle approche laisse à l’usager le choix de sa stratégie de prévention avec le raisonnement suivant : bien sûr, il vaut mieux ne pas consommer des drogues, mais si l’usager veut malgré tout en consommer, il vaut mieux consommer les drogues les moins dangereuses et de la façon de la moins dangereuse possible ; il vaut mieux ne pas recourir à l’injection ; pour ceux qui ne peuvent y renoncer, il faut utiliser des seringues stériles. Le raisonnement de la réduction des risques est celui de toute stratégie de prévention mais dans le domaine des drogues, ce raisonnement va à l’encontre de l’objectif des politiques prohibitionnistes, à savoir l’éradication des drogues. C’est aussi aller à l’encontre de la diabolisation des drogues qui fait de l’usager de drogue un junky, sans foi ni loi. Le “ toxicomane ” ou maniaque du toxique y a acquis un nouveau statut, celui d’usager, devenu “ citoyen comme les autres ”. Ces nouveaux comportements se sont expérimentés dans différentes associations, réunies un temps dans le collectif “ Limiter la Casse ”. Militants associatifs de la lutte contre le sida ou de l’humanitaire, médecins, usagers de drogues, chercheurs y ont confronté leur expérience, personnelle ou professionnelle. Cette confrontation est à l’ origine d’ une nouvelle expertise comme elle est à l’ origine du développement des actions, programmes d’échange de seringue ou boutiques, qui s’ouvrent un peu partout en France entre 1993 et 1995.L’alliance a été nécessaire pour que les acteurs puissent s’affronter à leurs propres croyances ; elle s’ est faite sous l’ influence de la lutte internationale contre le sida. Droits de l’ homme, protection de la santé, mobilisation communautaire : tels sont les principes de cette lutte. Il aura fallu quelque 10 années pour que les Français puissent s’approprier cette nouvelle approche de la santé publique fondée sur la citoyenneté et non plus sur l’autorité.
Droit de l’homme, citoyenneté, responsabilité, voilà un discours bien angélique. Qui aurait pu penser que ces belles paroles puissent avoir une quelconque efficacité ? C’est pourtant ce qui s’est passé. Aujourd’hui, 4% des cas de sida sont dus à l’injection intraveineuse ; en 1990, le pourcentage était de quelque 30%. Il y a bien eu changement de comportement des héroïnomanes ; il y a eu parallèlement changement de comportement de médecins. Désormais, ces patients “ comme les autres ” sont reçus par les médecins généralistes et ils ne meurent plus devant les portes de l’hôpital. C’est ce que montre la baisse vertigineuse de la mortalité qui ne se limite pas aux 500 overdoses comptabilisées ; avec les traitements de substitution, toutes les causes de mortalité, des septicémies aux suicides ou accidents, sont réduites. Plusieurs facteurs ont contribué aux bons résultats. Ainsi la réduction des 2/3 de la mortalité par sida est due à l’efficacité des médicaments anti-viraux mais sans traitements de substitution, les héroïnomanes auraient eu les plus grandes difficultés à suivre ces traitements contraignants. Autre facteur favorable, après dix à quinze années d’une vie violente et chaotique, les héroïnomanes des années 80, sont devenus demandeurs de soin tandis que l’héroïne perd de son pouvoir d’attraction auprès des plus jeunes. La désaffection progressive de l’héroïne, a certainement contribué à ces bons résultats ; et cependant ceux-ci sont directement corrélés à l’accès aux médicaments et selon l’évaluation nationale, il s’agit essentiellement du Subutex. Pour la médecine positiviste, les bons résultats démontrent que les héroïnomanes sont des malades ; il faut donc les soigner. Pour les anti-prohibitionnistes, c’est plutôt la preuve qu’il faut donner accès au produit. Les uns et les autres ont d’excellents arguments; la dépendance à l’héroïne est bien une maladie chronique et le caractère illégal de l’héroïne engendre nombre de risques, tels les produits frelatés ou encore l’absence d’hygiène liée aux injections clandestines. Et cependant, dans le système actuel, il ne suffit pas de mettre sur le marché un médicament ou un produit en vente libre pour réduire les risques. Le produit en vente livre (telle la codéine en France) ou bien la prescription de méthadone peut s’ajouter aux drogues illicites sans modifier les risques sanitaires et sociaux. Pour qu’il y ait amélioration des résultats, il faut que les héroïnomanes changent de comportement. L’appel à la responsabilité ne s’est pas fait en vain. La logique de la réduction des risques conduit à ce que “ ces patients comme les autres ” aient les mêmes droits que les autres. A minima, c’est renoncer à la pénalisation de l’usage qui fait du toxicomane un délinquant. Les spécialistes en toxicomanie, réunis dans l’Association Nationale des Intervenants en toxicomanie (l’ANIT) ont effectivement pris position contre la pénalisation de l’usage ; c’est aussi la position adoptée par le Conseil National du sida (13). Avec la lutte contre le sida, a émergé une nouvelle conception de la santé publique qui n’est plus imposition d’une norme mais qui repose sur la responsabilité du citoyen tandis qu’il relève de la responsabilité des pouvoirs publics d’informer le consommateur et de prendre les mesures de contrôle qui garantissent la meilleure protection des plus fragiles, en particulier des mineurs. L’interdiction de la publicité est un des outils de contrôle. Il en est d’autres qui portent sur le produit lui-même, de la production à la vente. La santé publique ne conduit pas nécessairement à l’arrêt de la prohibition de toutes les drogues, mais elle conduit à examiner l’efficacité des mesures au regard de la réalité des risques. C’est le travail mené en 1997 sous la direction du Pr. Roques à la demande de Bernard Kouchner (12). La synthèse des recherches scientifiques aboutit à un classement des drogues psychotropes en trois catégories : les plus dangereuses, à savoir l’héroïne, la cocaïne et l’alcool, une classe moyenne comprenant le tabac, les médicaments psychotropes, les amphétamines et enfin le psychotrope le moins dangereux (ce qui ne signifie pas sans dangers), le cannabis : Voilà qui n’a pas grand-chose à voir avec le classement imposé par les conventions internationales. L’évaluation scientifique des risques ne débouche pas automatiquement sur un modèle politique; du moins les experts de la santé publique ont-ils désormais les moyens de refuser l’utilisation abusive dont, il faut bien dire, ils ont été longtemps les complices.Dépénalisation de l’usage, prévention dont l’objectif est la lutte contre les usages nocifs ; telles sont les recommandations auxquelles aboutit logiquement la démarche de santé publique. Mais si la santé publique se doit de proposer un classement des drogues fondé sur la réalité des risques, le choix du maintien ou de l’arrêt de la prohibition pour les drogues les plus dangereuses n’est pas de sa compétence. En dernière instance, le choix d’une stratégie de contrôle dépend de la conception de que l’on a du rôle de l’Etat ; il s’agit donc d’un choix de société qui doit relever d’un débat citoyen (13). Or la question des drogues met en jeu à des logiques économiques, politiques et financières, telle la circulation de l’argent sale qui mettent en jeu des intérêts auxquels peu d’hommes politiques osent s’affronter ; rien d’étonnant si la remise en cause du régime prohibitionniste n’est pas, aujourd’hui, sur l’agenda politique. Seule l’opinion publique pourrait faire contrepoids ; et pour le moment, la violence, l’exclusion sociale, la perte du contrôle de soi font peur, sans qu’il soit possible de discerner clairement ce qui relève des drogues elles-mêmes et ce qui relève des politiques. Il faut bien constater que les expérimentations, qu’il s’agisse de cannabis ou d’héroïne, deviennent acceptables dès celles qui sont conduites par les médecins. C’est insuffisant car la réponse médicale ne répond qu’à une petite partie des problèmes liés aux drogues ; du moins dont-on faire en sorte que les médecins assument cette partie-là, dans la limite de leur déontologie. De façon souterraine, nous sommes en train de fabriquer d’autres façon de faire avec les drogues. La démarche est souterraine parce qu’elle va à l’encontre des politiques internationales fondées sur l’interdit et la répression. Pour le moment, ces nouvelles démarches ne sont pas revendiquées comme politiques de drogues, à l’exception des Pays-Bas et de la Suisse ; aussi n’ont-elles pas de cadre juridique ; c’est leur faiblesse ; elles dépendent de l’initiative citoyenne et de la bonne ou de la mauvaise volonté des politiques ; à ce titre, elles sont aujourd’hui menacées par la montée de la demande sécuritaire comme par le recul des politiques sociales et sanitaires. Et pourtant, elles ont fait la preuve de leur efficacité en même temps que de leur acceptabilité. Ces expérimentations sont actuellement en cours dans différentes villes européennes. Cela ne veut pas dire que la démarche est simple ; il n’y a pas dans les drogues comme dans toutes les politiques sanitaires et sociales de réponses magiques. Il faut sortir de l’illusion prohibitionniste qu’il y a “ La ” solution en matière de drogues. Il faut sortir du Tout ou Rien et considérer que toute amélioration conduit sur le bon chemin parce que la fin de la politique désastreuse actuelle se construit pas à pas, par les moyens qu’on utilise. Pour le moment, la réduction des risques est le seul frein à l’escalade continue de la répression – car la guerre à la drogue fait rage ; elle remplit sans doute pour moitié les prisons du monde. Ni la dépénalisation de l’usage, ni les prescriptions médicalisées, ni la vente contrôlée de cannabis ne résoudront l’ensemble des problèmes liés aux drogues. Des modes de gestion doivent être expérimentés en fonction de la nature des produits, des usages et des populations ; à chaque fois, un débat public est nécessaire ; il doit déterminer ce qui relève des libertés individuelles, ce qui relève de la responsabilité des pouvoirs publics. Expérimentation de nouvelles modalités de contrôles, la réduction des risques est aussi une démarche de négociation dont l’objectif est une co-existence plus pacifique entre ceux qui consomment des drogues et ceux qui n’en consomment pas. Bon gré, mal gré, nous devons co- exister avec les drogues – et avec ceux qui en font usage. Civiliser les drogues, c’est civiliser à la fois ceux qui se droguent et ceux qui ne se droguent pas (14)
Références
1. EMANUELLI J., rapport SIAMOIS, Contribution à l’évaluation de la politique de réduction des risques, Institut de Veille Sanitaire. Tome I et II. Novembre 2000 2. OLIN N., PLASAIT B., Drogue, l’autre cancer, Les rapports du Sénat, n°321, 2002-2003 3. PELLETIER M., Rapport de la mission d’étude sur l’ensemble des problèmes de la drogue, Paris, La Documentation Française, 1978. 4. Sur l’analyse de la médicalisation dans les années 70, voir CASTEL R., La Gestion des risques, Minuit, Paris, 1981. 5. SZASZ T., La Persécution rituelle des drogués, boucs émissaires de notre temps. Le contrôle de l’Etat thérapeutique, Editions du Lézard, 1994. 6. MOREL A., La Défaite de la santé publique, Flammarion, Forum, 1996. 7. HENRION R., Rapport de la commission de réflexion sur la drogue et la toxicomanie, Documentation Française, 1995. 8. LE MONDE DIPLOMATIQUE-MANIÈRE DE VOIR, n°56, Sociétés sous contrôle, mars- avril 2001, article “Le toxicomane apprivoisé” de Claude OLIEVENSTEIN. 9. PIGNARRE P., Les deux médecines, médicaments psychotropes et suggestion thérapeutique, La Découverte, 1995. 10. Pour une présentation de la réduction des risques, voir BURROW Effective approaches to HIV/AIDS and injecting drug use E: dbsyd@aol.com et STIMSON G, DESJARLAIS D.C. BALL, A., Drug injecting and HIV Infection WHO, 1998. 11. CONSEIL NATIONAL DU SIDA, Les risques liés aux usages de drogues comme enjeu de santé publique. Propositions pour une reformulation du cadre législatif, Rapport, 2001 12. ROQUES B., La Dangerosité des drogues, rapport au secrétariat d’Etat à la Santé, Editions Jacob, La Documentation Française, 1999. 13. NADELMANN E., “ Réflexions sérieuse sur quelques alternatives à la prohibition des drogues ”, Les Temps Modernes, Toxicomanie, sida, exclusion, n°567, Octobre 1993. 14. COPPEL A., Peut-on civiliser les drogues ? de la guerre à la drogue à la réduction des risques, La Découverte, 2002.